« L’anatomie d’une décision » ou le temps suspendu
« Imre ne mangeait plus d’orange depuis qu’il n’en obtenait qu’une ou deux à Noël chaque année, et encore fallait-il jouer de ses contacts auprès de ses chefs de rayon. Avant, ils en avaient des corbeilles entières pendant toute l’année. “Une seule orange, c’est pire que pas d’oranges !”» (p. 27)
Partir ou rester à Zalaegerszeg, petite ville hongroise, lorsqu’éclatent en 1956 les velléités insurrectionnelles des étudiants contre le gouvernement communiste à Budapest ? Tel est le dilemme qui incombe à Imre et Irma Spiegel, rescapés juifs de la Deuxième Guerre mondiale, alors que l’incertitude monte, qu’ils se sentent rattrapés par l’Histoire et que les événements réactivent les traumas du passé…
À travers L’anatomie d’une décision, la Suissesse d’origine hongroise Anna Szücs fait œuvre d’autobiographie – une autobiographie non pas personnelle, mais familiale. Car c’est l’histoire de ses propres grands-parents que l’auteure a choisi de nous raconter dans ce court roman de facture conventionnelle, avec ses temps de narration classiques et ses descriptions efficaces ; en quelques mots bien pesés, les tableaux de Lénine et Staline, les bâtiments aux hauts plafonds…, on est projeté dans cette histoire. On est surtout plongé dans le passé des pensées des personnages.
Passé antérieur
Pour parler d’un passé dans le passé, la langue a plusieurs temps appropriés, l’un d’eux étant le passé antérieur (antérieur à un autre temps, généralement le passé simple). Comme il dure dans sa mémoire, avec son introspection obsessionnelle relative à la guerre, ses ghettos et ses camps, Imre ne serait pas loin de vouloir en créer un nouveau, car le passé, le concernant, est loin d’être simple. Pour Irma, en revanche, ce serait le plus-que-parfait, vestige de l’empire austro-hongrois, ce temps où les femmes portaient des ombrelles et les hommes des chaînes de montre à la boutonnière. Aujourd’hui, les Spiegel ont perdu l’entreprise familiale, étatisée, et tout est gris, à l’image des bâtiments, sans fioritures, construits sous l’ère soviétique. Mais, « sous ce régime, les gens qui se pliaient aux règles n’allaient pas être persécutés. Il s’agissait du plus grand avantage du communisme aux yeux d’Imre. (…) Il sentait que ce qui arrivait à Budapest marquait peut-être le début d’une prochaine inversion du pouvoir » (p. 39).
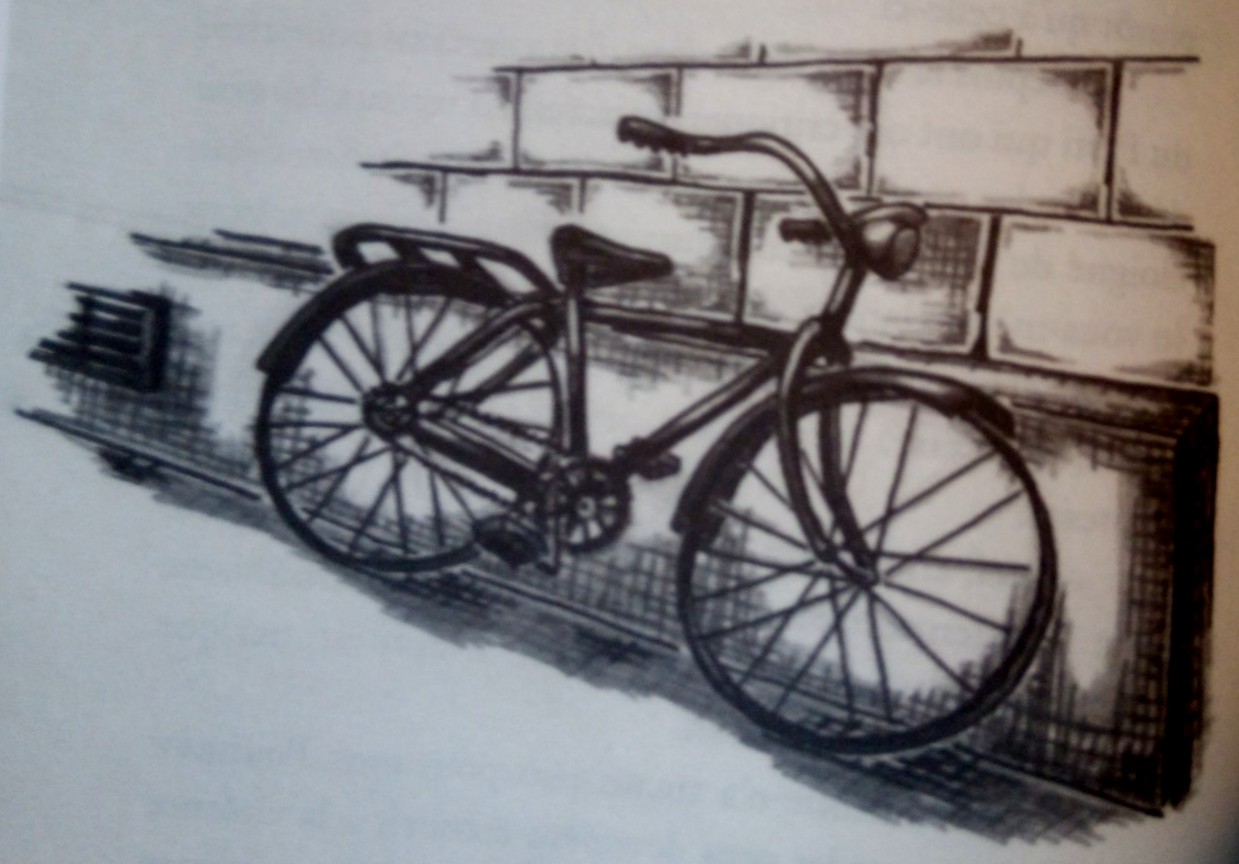
La paix, voilà à quoi cet homme meurtri par la guerre aspire par-dessus tout. La tranquillité pour lui et les siens. Or, avec les émeutes budapestoises, la parole se délie et le petit Andris, fils d’Imre et Irma, est victime d’un acte antisémite à l’école. La conviction profonde d’Imre lui intime que l’Histoire bégaie et qu’il est temps de partir. S’il l’avait pu, pendant la guerre, il aurait fui la Hongrie et sauvé sa famille des camps concentrationnaires. Or, aujourd’hui, il le peut. Il a l’argent et l’énergie nécessaires pour fuir en Autriche avec Irma et Andris, recommencer là-bas une nouvelle vie en démocratie. Pour autant, prendre ce genre de décision ne va pas sans conséquences. Aura-t-il la force de partir ou le courage de rester ?
Outre l’histoire, très documentée (ce qui se perçoit à travers des détails comme les articles en libre-service, exhibés en étalages dans les magasins lorsqu’il s’agit aux clients de les voir, et à la demande dans des tiroirs fermés pour les produits d’usage courant), ce qui fascine chez Anna Szücs, c’est la psyché de ses personnages – principalement Imre. On voit bien que ses études en psychiatrie ont nourri l’auteure, de même que ses recherches sur le rôle de la personnalité dans la prise de décisions…
« Papa, c’est quoi un juif ? » (p.88)
Le style est sec et nerveux, les chapitres courts. Et quand ils s’allongent, que le temps ralentit, c’est pour aborder la question de la religion. Imre a refoulé sa judéité, aidé en cela par un système communiste qui niait les religions en général, et se retrouve forcé de s’y replonger par la question de son fils. Une fois encore, si le sujet le gêne, ce n’est pas pour la religion en tant que telle mais parce qu’elle le renvoie au traitement des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Tout dans ce que Imre pense ou fait, se décide toujours en fonction de cet événement traumatique. En ce sens on peut dire qu’il ne vit pas au présent, mais dans un passé qu’il n’est jamais parvenu à surmonter.

Le temps disséqué
Le temps du roman est resserré sur sept jours, ce qui crée tension et suspense, durant une semaine qui va changer la vie des personnages. La décision du titre, mais aussi le quotidien, tout est disséqué avec une précision quasi chirurgicale, à la demi-heure près, parfois moins. C’est vrai, il ne se passe pas grand-chose dans cette petite ville isolée géographiquement (Budapest est à plus de 200 km) et comme coupée du temps qui passe (ainsi, les manifestations budapestoises ne sont tout d’abord qu’une rumeur, une crainte vague), la seule perspective temporelle, c’est la commémoration le 7 novembre de la Révolution d’Octobre. On songe à La plaisanterie de Milan Kundera, pour les intuitions biaisées que l’on peut bien souvent avoir, mais une plaisanterie vue de l’autre côté, non pas celui du parti mais des petites gens, ni communistes ni révolutionnaires et qui, de fait, peuvent craindre de voir les représailles s’abattre sur eux en double. Néanmoins, c’est davantage vers Julien Gracq que le roman lorgne – Gracq, cet écrivain de l’attente, capable de parler, 143 pages durant, des sentiments que l’attente de sa maîtresse lui inspire… pour s’arrêter au moment où la femme descend du train (La presqu’île, 1970). Pour Anna Szücs aussi, ce qui compte dans un voyage, ce n’est finalement pas tant la destination que le chemin parcouru, surtout s’il est mental.
Bertrand Durovray
Référence : Anna Szücs, L’anatomie d’une décision, Zalaegerszeg (Hongrie), Éditions Encre Fraîche, 2020, 165 pages.
Dessins : © Anna Szücs (montage : © Bertrand Durovray)

