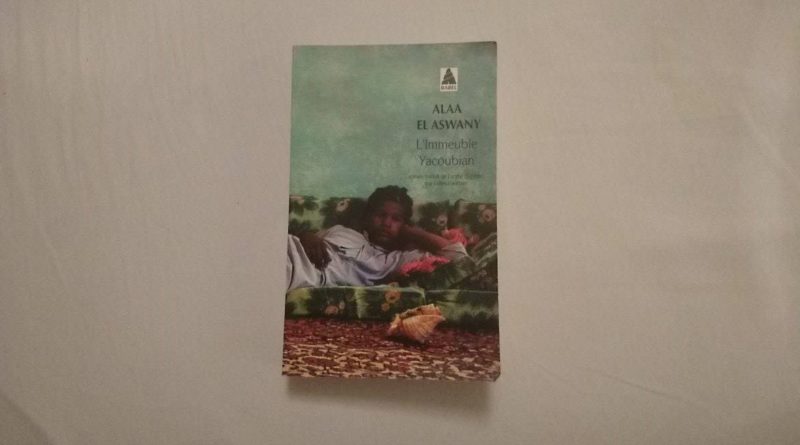La société égyptienne dans l’œil d’un égyptien
« En vieillissant, j’ai compris que l’homme n’a presque rien entre ses mains. Taha continue à lire des invocations jusqu’à ce que le soleil du matin brille dans la pièce et que, petit à petit, les cabanes de fer se mettent en mouvement : des voix, des cris, des rires, des quintes de toux, des portes qui se ferment et qui s’ouvrent, l’odeur de l’eau chaude en train de bouillir du thé, du café, du charbon de bois et le mouassel des narguilés. » (p. 24)
Construit au Caire en 1934 par le millionnaire Hagop Yacoubian[1], le luxueux immeuble à l’occidentale qui donne son nom à l’ouvrage de Alaa El Aswany a d’abord été habité par la fine fleur de la société égyptienne. Après la révolution de 1952[2], la population a changé, et l’on y rencontre différentes classes sociales, dont les plus modestes résident dans les cabanes de fer installées sur la terrasse du bâtiment. Alaa El Aswany s’attache aux plus représentatifs de ses habitants, dont il entrecroise les destinées comme autant de fils colorés formant la tapisserie de son roman. Il y a là Zaki Dessouki, vieil homme tendre et raffiné qui a consacré sa vie à la « science de la Femme » et qui garde la nostalgie de l’époque antérieure à la révolution, dont il idéalise la douceur de vivre ; Hatem, l’intellectuel né d’un père universitaire et d’une mère française, qui souffre de vivre son homosexualité d’une façon semi-clandestine ; Abdou, son amant, un homme du peuple qui se débat avec son sentiment de culpabilité ; Taha, l’étudiant brillant et plein de mérite, qui rêve d’entrer à l’école de police et s’en voit interdire l’accès parce qu’il est fils de concierge. Révolté par cette injustice, il se laissera séduire par l’islamisme le plus radical… Il y a aussi Azam, l’homme d’affaires libidineux dont la fortune tire sa source des trafics les plus inavouables ; Boussaïna, la fiancée de Taha, que sa jeunesse et sa pauvreté exposent aux désirs sordides de ses employeurs ; Malak, le tailleur de chemises avide, qui tisse sa toile comme une araignée pour s’emparer des locaux qu’il convoite, et beaucoup d’autres encore. Certains attirent une sympathie très vive, d’autres paraissent odieux, mais tous ont une épaisseur et un relief qui attestent le talent d’un authentique romancier.
Ce qui m’a marqué dans L’immeuble Yacoubian, c’est le portrait sans nuance ni atténuation/romantisme qui est fait d’une Égypte qui pourrait être actuelle. En effet, qu’il s’agisse de Boussaïna, qui est constamment confrontée au harcèlement sexuel, de la police qui règne sans partage et torture à gogo comme le montre le triste sort de Taha suite à son arrestation ou encore d’Hatem qui vit relativement mal son homosexualité, tous démontrent une Egypte ayant des soucis identiques ou presque à ceux des Occidentaux. Mais ce qui m’a réellement marquée, c’est le passage consacré à l’islamisme radical, qui prend de plus en plus de place – surtout chez les jeunes qui ne pensent pas avoir d’avenir (quel qu’il soit) dans leur pays. Ce passage met en scène Taha, qui ira jusqu’à entrer dans un camp d’entraînement suite au refus que lui oppose l’école de police.
« Ensuite les frères se réunissaient pour suivre des cours de fiqht, d’étude et de commentaire du Coran et de hadith, donnés par le cheikh Bilal et par d’autres oulémas. Quant à l’après-midi, elle était consacrée à l’entraînement militaire. Les frères (…) s’entraînaient au tir ainsi qu’à la fabrication et à la manipulation de bombes. » (p. 269)
Malgré toute cette noirceur, L’immeuble Yacoubian n’est pas un roman déprimant : l’auteur, au travers de ses personnages, laisse toujours transparaître une note d’amour, que ce soit pour les femmes, les hommes ou Dieu. Notamment lors de la brève histoire d’amour entre Boussaïna et Taha ou la relation quelque peu compliquée d’Hatem et Abdou. Qui plus est l’histoire se conclut sur une note très chaleureuse…Pour conclure, ce livre ne mérite pas son manque de visibilité médiatique au moment de sa sortie. De plus au vu de l’actualité djihadiste actuelle, il est fondamental à lire…
Bonne lecture !
Audrey Baans
Référence : Alaa El Aswany, L’immeuble Yacoubian, Arles, Actes Sud, 2006, 324 p.
Photo : ©Audrey Baans
[1] Hagop Yacoubian, président de la communauté arménienne d’Égypte.
[2] Nasser et d’autres « officiers libres » renversent la monarchie égyptienne sans effusion de sang. Un an plus tard, Gamal Abdel Nasser prend le pouvoir.