Les séismes du genre
« En bon scientifique, mon père nous avait employé les termes normatifs. Dysphorie de genre. Transidentité. Trouble de l’identité de genre. Non-congruence de genre. Ma mère n’y comprenant rien, mon père était passé au plan B. “Je suis une femme. À l’intérieur, une vraie. Ce n’est vraiment pas grave. Je t’aime. Je vous aime. Mais je n’ai jamais été un homme.” » (p. 22-23)
Aujourd’hui, j’aimerais vous parler d’un roman qui m’a, ces dernières semaines, profondément marquée. Qui ne m’a pas laissée indifférente. Qui ne peut pas laisser indifférent.e – je crois. Son titre ? Mon père, ma mère, mes tremblements de terre. Publié en 2020 chez Belfond, il s’agit du cinquième roman de Julien Dufresne-Lamy, un écrivain français prolifique en littérature générale et jeunesse que j’ai rencontré lors de la dernière édition du Festival du Premier Roman de Chambéry, organisée par l’association Lectures Plurielles.
Temps & durée en salle d’attente
Tout se passe à deux pas d’un bloc opératoire, entre les quatre murs d’une salle d’attente. Charlie, quinze ans, pianote sur son téléphone portable. Son regard va du sol à la plante verte, de la porte aux chaises, de ses mains à sa mère qui l’accompagne. Il est nerveux. Il trompe le temps. Tout se passe donc là, en huis-clos – ou presque, et c’est dans ce presque que réside l’importance du roman de Julien Dufresne-Lamy. Car ce que Charlie attend, c’est une métamorphose. Une renaissance. Une transition.
« Mon père est parti sur son brancard. Il portait une charlotte blanche, des bas de contention en coton élastique et une longue blouse en polyester qui lui démangeait les épaules. » (p. 9)
À partir de cet incipit, Charlie, le narrateur, dresse méthodiquement le compte à rebours de l’opération. Dans quatre heures, son père ne sera plus. Dans quatre heures, son père sera. Quatre heures pour changer à jamais. Quatre heures pour être enfin ce qu’on a toujours été, au fond de soi. Dans cette salle d’attente, le temps devient pour Charlie ce que le philosophe Henri Bergson (1859-1941) analyse si bien dans son Essai sur les données immédiates de la conscience, en 1889. Pour Bergson, il est possible d’opposer le temps de la science et la durée de la conscience. Autrement dit, il existe un temps extérieur, objectivable, quantifiable (le temps, par exemple, qu’il faut pour faire fondre un morceau de sucre dans l’eau… ou pour lire un roman de Julien Dufresne-Lamy), et une durée intime, personnelle, impossible à mesurer car liée à la conscience et donc, différente pour chacun.e selon les circonstances : ce sera alors la durée qu’éprouvera l’humain frappé d’hypoglycémie qui attend son verre d’eau sucrée… ou la lectrice passionnée qui dévore Mon père, ma mère, mes tremblements de terre.
Sismographe familial
Charlie éprouve donc le concept de la durée, qui passe à la fois trop lentement et trop rapidement. Heure après heure, il nous fait sentir le poids de l’attente et, parce que la durée est subjective, quitte par saccades l’instant présent, celui de la narration, pour voyager à loisir dans la chronologie de cette transition paternelle : les chapitres alternent par conséquent entre les moments vécus dans la salle d’attente de l’hôpital et ceux traversés au cours de ces derniers mois. Ses mots d’ado passionné de science font de l’événement un tremblement de terre, dont le point zéro reste ancré dans sa mémoire.
« Mon père et ses tremblements de terre, j’y pense tous les jours. C’était il y a deux ans. L’année de ma quatrième. J’étudiais les séismes en classe et pour mon plaisir je lisais un paquet de notions sur les plaques tectoniques. Notre épicentre a eu lieu pendant les vacances de Pâques. Maman s’était arrangée avec les familles des enfants qu’elle garde et on était partis tous les trois une semaine dans un camping deux étoiles à Noirmoutier. » (p. 22)
À partir de là, Charlie file la métaphore pour exposer non seulement les secousses de son père – mais aussi celles de sa mère et surtout, les siennes. Car en exprimant son point de vue à la première personne, il ne prend pas la place de la personne qui vit la transition, mais de celui qui en est témoin. Ainsi, Mon père, ma mère, mes tremblements de terre est davantage qu’un titre ; c’est le programme ambitieux que se donne l’auteur Julien Dufresne-Lamy, pour comprendre la transition à travers les yeux d’un narrateur extérieur à l’expérience – avec tous les tâtonnements que cette idée comporte.
Si Mon père, ma mère, mes tremblements de terre m’a touchée, ce n’est pas seulement à cause du thème fort qu’il aborde. Julien Dufresne-Lamy est un habitué des sujets exigeants : Jolis Jolis Monstres, notamment, traitait en 2019 de l’univers des drags queens, depuis les années Sida jusqu’à aujourd’hui. Ce qui m’a fascinée dans l’histoire de Charlie, c’est la manière d’aborder la question. Sans simplification. Sans manichéisme. Sans militantisme. Mais avec beaucoup, beaucoup de tendresse. Les mots de Charlie ont sonné justes, pour moi, parce qu’ils ne cherchent rien à cacher. Ils expriment le long et ardu parcours d’un fils, d’un adolescent en plein construction de son « lui » à venir, qui apprend que son père n’a jamais été un homme, que son père n’a jamais pu se construire harmonieusement – jusque-là. Charlie est un ado qui, bien qu’il en comprenne l’importance, a peur de ce changement, peur de s’éloigner de ce géniteur auquel il ressemble tant, de ce chimiste génial de qui il tient son amour pour les sciences. Ce que Charlie ressent en premier, c’est un choc. De la colère. Un refus de comprendre :
« Je crois que je n’ai pas toujours aimé mon père. Je crois que non. Je crois qu’à cette époque, mon amour devenait invisible et molécule. À la place, c’est la colère qui me calcinait. Parce que le monde ne tournait plus qu’autour de lui, ce père si grand et si volumineux qui jacassait, riait, parlait sans cesse, agitant ses poignets épais comme des crécelles. C’était normal et hormonal, mais peu importe, à petit feu, ça me faisait disparaître. » (p. 40)
Harcelé par ses camarades de classe, il refuse tout d’abord d’accepter l’évidence. Au fil du temps, des premières consultations, des premiers traitements, des nouvelles habitudes vestimentaires assumées avec toujours plus d’assurance, des doutes et des questionnements, il va lentement chercher à comprendre. Avec méthode, il va tenir un journal d’observation à l’insu de ce père qu’il a peur de ne plus comprendre. Il y détaille le moindre soubresaut sismographique qui agite sa famille, les effets (positifs ou négatifs) des médicaments, le travail sur la voix, les déboires professionnels, les petites victoires du quotidien, les problèmes de couple – sans oublier les insultes des autres, qu’il appelle des « mots d’amour » comme pour en effacer par l’humour le caractère dégueulasse. Il dit l’espoir et la dépression de sa mère, aussi. Puis l’acceptation qui se noue pas à pas.
Alice, en 249 pages
Cette acceptation apparaît non seulement dans l’histoire que raconte Charlie – mais aussi dans les mots mêmes qu’il utilise. Alors qu’au début du récit, il associe encore son père à une troisième personne du singulier masculine et bien établie (un « il » qui semble se dresser, hiératique et indéboulonnable, entre le souvenir qu’il conserve de son père et la personne qu’il attend de voir sortir du bloc opératoire), une rencontre va changer profondément sa vision des choses. Cette rencontre, c’est celle de Marin.
« Face à moi, la fille est un garçon. Il s’appelle Marin. Avant, c’était Marine mais c’était tout autant un mensonge cousu de fil de sang sous sa grande peau blanche. C’est vrai que Marin ressemble à un garçon. Il en a l’attirail, les traits, la trempe, les imprévisibles débordements. À vue de nez, il a seize ans. Peut-être dix-sept. Marin nous dit qu’il ne voulait pas de prénom héroïque. Il voulait faire simple comme la mer. Retirer la voyelle. » (p. 77)
Marin va ouvrir les yeux de Charlie – ou plutôt, va permettre à Charlie de les dessiller complètement. Grâce à son écoute et son amitié, Charlie va parvenir à mettre un mot sur son père : « elle ». Avec empathie, Julien Dufresne-Lamy accompagne alors son narrateur dans cette transition grammaticale, émaillant toujours plus son texte de phrases qui redistribuent résolument les cartes des genres :
« Un an après la nuit du camping, je comprends que pour le monde, une femme n’est jamais une femme que comparée à une autre et, dans mes raisonnements scientifiques, oui je compare, je fais de l’échantillonnage, et mon père résulte femme, vérifiée femme, […] mon père est elle, pleine et entière de femme, nouée femme pour l’éternité. Je dois pouvoir le formuler. Puisqu’elle est elle, en stricte vérité. » (p. 157)
« Mon père est chimiste et elle ressemble à son métier. Elle aime son laboratoire comme une chambre à soi. Elle y travaille depuis vingt et un ans à créer des molécules complexes, des principes actifs de médicaments et des produits phytosanitaires. » (p. 174)
Au final, il faudra au père de Charlie 249 pages pour devenir Alice aux yeux de son fils qui l’attend à la sortie du bloc. 249 pages pour devenir cette femme qu’elle a toujours été, pour achever cette opération qui la fera devenir enfin elle-même… libre de rester l’épouse de sa femme et le père de son fils. Libre de vivre. Libre d’être. Libre.
Magali Bossi
Références : Julien Dufresne-Lamy, Mon père, ma mère, mes tremblements de terre, Paris, Belfond 2020.
Photo : © Magali Bossi

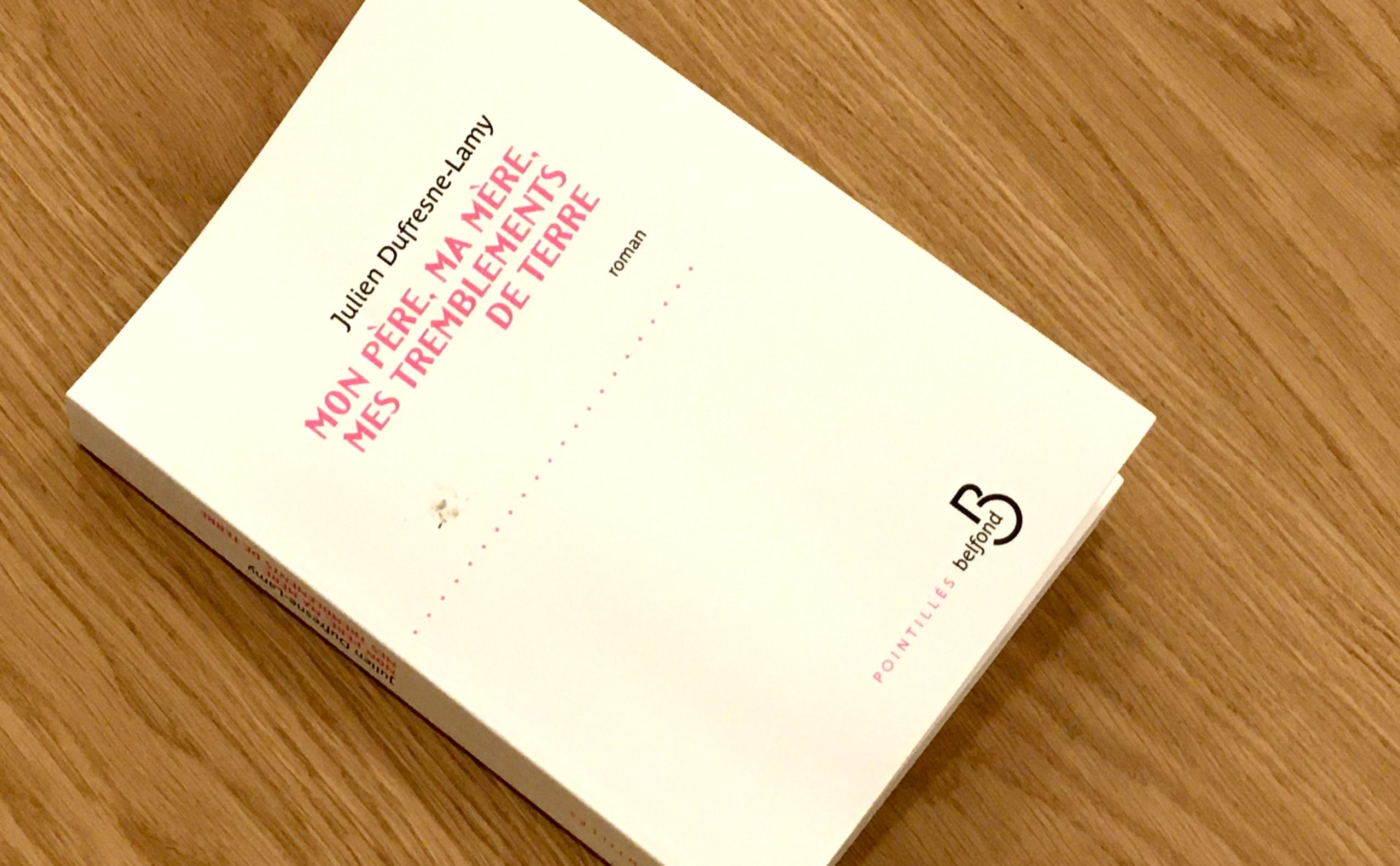
Merci pour cette critique ! Je commence ma liste de Noël 😉 !